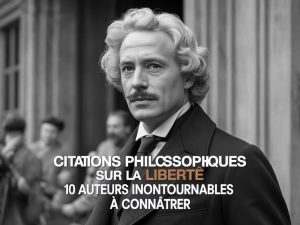Programme de philosophie en terminale : thèmes, notions et auteurs au bac

Programme de philosophie en terminale : thèmes, notions et auteurs au bac
Le bac approche et avec lui, une épreuve qui continue d’interroger, de faire douter ou d’émerveiller : la philosophie. Matière singulière par excellence, elle demande autant de rigueur que de réflexion personnelle. Que contient exactement le programme de philosophie en terminale ? Quelles notions faut-il maîtriser ? Quels sont les auteurs incontournables ? Dans cet article, je vous propose une vue d’ensemble claire et structurée du programme, pensée comme un guide stratégique pour aborder sereinement l’épreuve.
Pourquoi un programme national de philosophie ?
La philosophie reste une des rares disciplines dont le programme est unique à l’échelle nationale. Cela signifie que les candidats, quel que soit leur établissement, préparent les mêmes thèmes, abordent les mêmes notions. Pourquoi cette uniformité ? Tout simplement parce qu’elle garantit une égalité entre tous les élèves devant l’épreuve du bac. Plus encore, elle incarne la volonté républicaine de donner à chacun les outils pour penser librement et rigoureusement le monde.
Le programme officiel est défini par le Bulletin Officiel et décline un ensemble de notions regroupées en thématiques générales. Il ne fixe pas un parcours linéaire : il appartient à chaque enseignant de choisir les problématiques, les œuvres et les auteurs à étudier pour aborder ces notions. Mais les attentes restent les mêmes à l’évaluation.
Les grands thèmes du programme de philosophie
Le programme s’organise autour de 17 notions réparties en 4 grands champs de réflexion. Chaque notion correspond à un objet philosophique que vous devrez être capable de définir, d’interroger, et de discuter à travers divers auteurs et exemples. Voici un aperçu pratique :
Le sujet
- La conscience
- L’inconscient
- Le désir
- La liberté
- Autrui
On commence par le plus proche : nous-mêmes. Ce bloc invite à s’interroger sur ce qui fait notre identité personnelle, nos désirs, nos choix, nos relations aux autres. Des questions simples en apparence — suis-je libre ? — se transforment très vite en problématiques complexes.
Exemple concret : Quand vous « choisissez » de réviser au lieu de sortir, êtes-vous libre ou seulement contraint par la peur de l’échec ? La distinction entre liberté de spontanéité et liberté réfléchie devient ici cruciale.
La culture
- L’art
- Le travail
- La technique
- Le langage
Ici, la philosophie étudie ce que l’humain a produit pour se dépasser : sa culture. Cette partie du programme pose des questions sur le rôle du langage dans la pensée, sur la fonction de l’art dans la société, ou encore sur la technique comme instrument de maîtrise — ou d’aliénation.
Un exemple qui parle : L’intelligence artificielle peut-elle créer une œuvre d’art authentique ? Qu’est-ce qu’un artiste apporte que l’algorithme ne peut pas simuler ? Voilà un enjeu contemporain qui vous permettra de faire des ponts entre la philosophie et l’actualité.
La raison et le réel
- La nature
- La raison
- La vérité
C’est le noyau dur de la réflexion philosophique. Ces notions vous amènent à explorer ce qu’est la connaissance, comment elle se construit, et surtout ce qui sépare le vrai du vraisemblable. La science est ici en ligne de mire, mais aussi les croyances, les préjugés, et les dérives des médias.
Entre en jeu : Peut-on tout prouver ? Le doute cartésien, critique mais méthodique, devient ici un outil précieux, tout comme la rigueur argumentaire des démonstrations scientifiques.
La politique et la morale
- La justice
- Le droit
- La politique
- La morale
- L’histoire
Dans cette dernière section, la philosophie sort de l’individu pour penser le collectif. Que signifie vivre ensemble ? Qu’est-ce qu’une société juste ? Peut-on désobéir à la loi au nom de la morale ? Ces questions prennent une résonance particulière face aux enjeux actuels (gilets jaunes, guerre, crises sanitaires, etc.).
À méditer : Doit-on toujours respecter la loi ? Le cas de Rosa Parks, refusant de céder sa place dans un bus, vous permet d’illustrer la tension entre droit et justice.
Zoom sur quelques auteurs incontournables
Inutile de connaître des dizaines d’auteurs. Mieux vaut maîtriser quelques grandes figures bien choisies, capables d’éclairer plusieurs notions. Voici une sélection stratégique :
- Platon : idéal pour l’art, la justice, la vérité.
- Descartes : incontournable pour la raison, la vérité, la conscience.
- Kant : solide pour la morale, le devoir, la liberté.
- Marx : précieux pour le travail, la société, l’idéologie.
- Sartre : un pilier pour le désir, la liberté et l’existence.
- Freud : indispensable pour l’inconscient et la conscience.
Retenez un principe : chaque auteur peut être mobilisé sur plusieurs notions. Ayez donc 4 ou 5 auteurs transversaux, que vous pouvez citer à bon escient dans différentes dissertations ou explications de texte.
Quels types d’épreuves au bac ?
Au bac de philosophie, vous avez le choix entre trois sujets :
- Deux dissertations (chacune portant sur une notion différente du programme).
- Une explication de texte philosophique.
Vous choisissez le sujet qui vous inspire le plus. La dissertation évalue votre capacité à problématiser une notion et construire une argumentation rigoureuse. L’explication de texte demande plus de sens de l’analyse et une compréhension fine des concepts.
Bons réflexes :
- Relisez toujours les notions du sujet — une mauvaise interprétation est fatale.
- N’attaquez pas l’écriture sans problématique claire et plan structuré.
- Illustrez chaque idée par un exemple et un auteur.
Comment bien réviser ce programme ?
Un bon plan de révision repose sur trois piliers :
- Fichez les notions : définition, problématiques possibles, auteurs associés, exemples.
- Entraînez-vous : travaillez à partir de sujets types (dissertations, textes).
- Aérez votre mémoire : utilisez des cartes mentales, schémas ou résumés visuels.
Petit conseil pratique : à deux semaines du bac, concentrez-vous sur les notions que vous maîtrisez le mieux et reliez-les entre elles. Ce tissage conceptuel vous permettra d’affronter la dissertation avec souplesse.
Et en SPE ?
Si vous êtes en terminale spécialité « Humanités, littérature et philosophie », le niveau d’approfondissement est plus poussé, et certains auteurs sont étudiés à travers des œuvres intégrales. Toutefois, l’ossature du programme reste proche, et les compétences attendues sont similaires : analyser, argumenter, conceptualiser.
Un mot en passant sur la philo en voie technologique
Pour les élèves de terminale technologique, le programme est plus restreint (autour de 7 notions), et l’épreuve au bac comporte uniquement une dissertation. Les attentes sont adaptées : on évalue la capacité à raisonner clairement, structurer sa pensée et mobiliser les connaissances de manière pertinente. L’essentiel est de ne jamais rester dans le flou ou l’opinion gratuite.
Un exemple utile : Le lien entre travail et dignité — sujet très présent en voie techno — peut être traité à travers des éléments concrets du monde professionnel, mais toujours éclairés par des repères clairs.
L’astuce Stephilo
Gardez toujours à l’esprit que le bac de philo, ce n’est pas une affaire d’inspiration mais de méthode. Si vous êtes capable de construire une problématique, de définir précisément les termes du sujet, de proposer une argumentation étayée par des exemples et des références philosophiques, vous avez déjà fait 80 % du chemin.
Rappelez-vous enfin que philosopher, c’est d’abord apprendre à se poser les bonnes questions. Ne soyez pas obsédé par la « bonne réponse ». C’est le cheminement de pensée qui est évalué. Et cela, croyez-moi, c’est à votre portée.
Bonnes révisions à tous, et n’oubliez pas : la philosophie, c’est un sport intellectuel. Comme tout sport, elle demande de l’entraînement… et un peu de plaisir aussi.