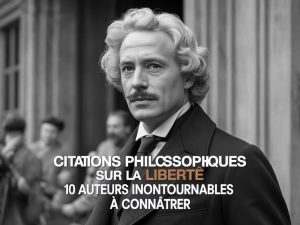Introduction Olympe de Gouges : bio, combat et pensée politique au siècle des Lumières

Introduction Olympe de Gouges : bio, combat et pensée politique au siècle des Lumières
Une femme éclairée dans un siècle d’hommes : qui est Olympe de Gouges ?
Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, est l’une des figures les plus singulières et audacieuses du XVIIIe siècle. Femme de lettres, dramaturge, mais surtout esprit libre et précurseur du féminisme, elle s’est imposée dans un monde qui ne tolérait guère la parole féminine dans la sphère politique. À une époque où la Révolution française rebat les cartes des droits et des libertés, elle ose un geste inouï : revendiquer l’égalité entre les sexes.
Née en 1748 à Montauban, Olympe n’a pas suivi un parcours académique. Et c’est justement ce qui fait sa force : autodidacte, elle cultive une pensée indépendante, non formatée par les institutions. Mariée contre son gré très jeune, elle devient veuve à 18 ans. Ce tournant biographique est pour elle une libération : elle refuse de se remarier, monte à Paris, adopte un nom d’écriture et entame une carrière littéraire.
Olympe de Gouges au cœur du siècle des Lumières
Pour comprendre le sens de son combat, il faut le replacer dans le contexte des Lumières. Diderot, Voltaire, Rousseau ou encore Montesquieu popularisent les idées de liberté, de tolérance, de progrès et de raison. Mais quand il s’agit des droits des femmes, le discours s’arrête souvent aux portes du masculin.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, pilier des valeurs révolutionnaires, affirme haut et fort l’égalité des citoyens… mais ne dit rien des citoyennes. C’est ce silence qu’Olympe va briser, non sans courage. Elle montre ainsi que, même parmi les philosophes éclairés, certains sont restés dans l’ombre en matière d’égalité de genre.
Et si l’on se pose la question : pourquoi Olympe de Gouges a-t-elle risqué sa vie pour une idée aussi radicale à l’époque ? Parce qu’elle a compris que sans les femmes, la liberté est incomplète. Sa pensée s’inscrit dans une logique de cohérence révolutionnaire : si l’on proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux, cela doit aussi inclure les femmes, non ?
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : un manifeste avant-gardiste
Le texte le plus célèbre d’Olympe, rédigé en 1791, est sans conteste sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En miroir ironique à la Déclaration de 1789, elle en reprend la structure et les articles… mais en les reformulant pour y inclure les femmes.
Quelques articles clés :
- « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits » (article 1).
- « La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ».
- Elle y ajoute même un contrat social entre l’homme et la femme dans le mariage, ce qui est révolutionnaire en soi pour l’époque.
Ce texte ne se contente pas d’affirmer l’égalité abstraite, il en déduit des conséquences concrètes : la participation politique des femmes, leur droit à l’éducation, à l’expression, à la propriété, et même au divorce. En somme, c’est toute une conception de la société qu’elle propose de refonder sur l’égalité réelle, pas seulement théorique.
Une pensée politique lucide et offensive
Ce qui frappe chez Olympe, c’est la cohérence de sa démarche. Elle ne parle pas d’égalité comme d’une valeur morale abstraite : elle l’applique partout, avec une logique implacable. Par exemple, dans plusieurs de ses écrits politiques, elle critique l’esclavage avec la même vigueur que le sexisme. Elle rédige des textes anti-esclavagistes bien avant l’abolition, dénonçant avec précision les intérêts économiques liés à cette injustice. Elle écrit même une pièce de théâtre, Zamore et Mirza, qui met en scène des esclaves noirs dans les colonies françaises. Ce n’est pas juste une posture : c’est un engagement total.
Ce positionnement courageux lui vaut de nombreuses inimitiés. D’une part, elle dérange les conservateurs monarchistes par ses idées révolutionnaires. D’autre part, elle irrite les Révolutionnaires eux-mêmes, notamment les Jacobins, pour avoir osé critiquer Robespierre et tenté de s’impliquer activement dans le débat public alors qu’elle n’était ni élue, ni homme.
Une voix dissidente en temps de révolution
On pourrait croire qu’en pleine Révolution, lorsque tout est censé être renversé, une femme comme Olympe aurait sa place. Mais c’est l’inverse qui se produit : son activisme politique est perçu comme dangereux. Son indépendance d’esprit – notamment sa défense de la monarchie constitutionnelle – la place entre toutes les lignes de fronts.
Elle est arrêtée en 1793, jugée sommairement pour avoir publié des écrits jugés hostiles au gouvernement révolutionnaire, puis exécutée en novembre de la même année. Selon les témoignages, elle aurait déclaré avant sa mort : « Si la femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir aussi celui de monter à la tribune ». Une formule qui résume toute la portée historique de son engagement.
Pourquoi étudier Olympe de Gouges aujourd’hui ?
Au-delà de son intérêt historique, la pensée d’Olympe de Gouges est d’une étonnante actualité. À l’heure où les débats sur l’égalité de genre, la place des femmes dans les institutions ou les violences faites aux femmes restent brûlants, son œuvre invite à ne pas perdre de vue l’essentiel : les droits ne sont jamais définitivement acquis, ils sont toujours à défendre et à actualiser.
Travailler sur Olympe de Gouges au lycée, que ce soit en philosophie, en histoire ou en français (grâce à ses textes littéraires), permet de croiser plusieurs axes pédagogiques :
- Analyser un texte argumentatif dans un contexte historique complexe.
- Débattre autour de la notion d’égalité et de ses limites pratiques.
- Comparer des discours philosophiques – Rousseau, Voltaire, Olympe – pour mieux cerner les tensions du siècle des Lumières.
- Réfléchir à la notion d’engagement : qu’est-ce qu’un engagement intellectuel réel ? À quelles conditions ce dernier a-t-il un impact ?
En résumé, Olympe n’est pas seulement une figure féminine à « ajouter » à un récit révolutionnaire trop masculin. Elle en est un jalon essentiel, car elle interroge le cœur même des principes républicains lorsqu’ils oublient la moitié de l’humanité.
Quelques pistes pour approfondir et réviser
Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin – ou les enseignants qui veulent compléter leur cours – voici quelques ressources utiles :
- Texte intégral de la Déclaration des droits de la femme : disponible sur Gallica ou dans les anthologies de textes révolutionnaires.
- Extraits de ses pièces comme Zamore et Mirza : utiles pour montrer comment elle utilise le théâtre à des fins politiques.
- Émissions radio (France Culture – Les grandes traversées) consacrées à son parcours.
- Comparatif entre sa Déclaration et celle de 1789 : excellent exercice de commentaire pour les terminales.
Enfin, pour ceux qui préparent le Bac, pensez à utiliser Olympe de Gouges comme exemple mobilisable aussi bien en dissertation (sujets sur la justice, l’égalité, la liberté) qu’en épreuve de culture générale ou de Grand Oral. C’est une figure qui, bien choisie, vous distingue intelligemment des références classiques.
Alors, la prochaine fois que vous entendez parler des Lumières, rappelez-vous qu’elles n’éclairaient pas toujours tout le monde. Mais certaines femmes comme Olympe ont allumé leur propre lanterne pour éclairer les marges de l’Histoire.